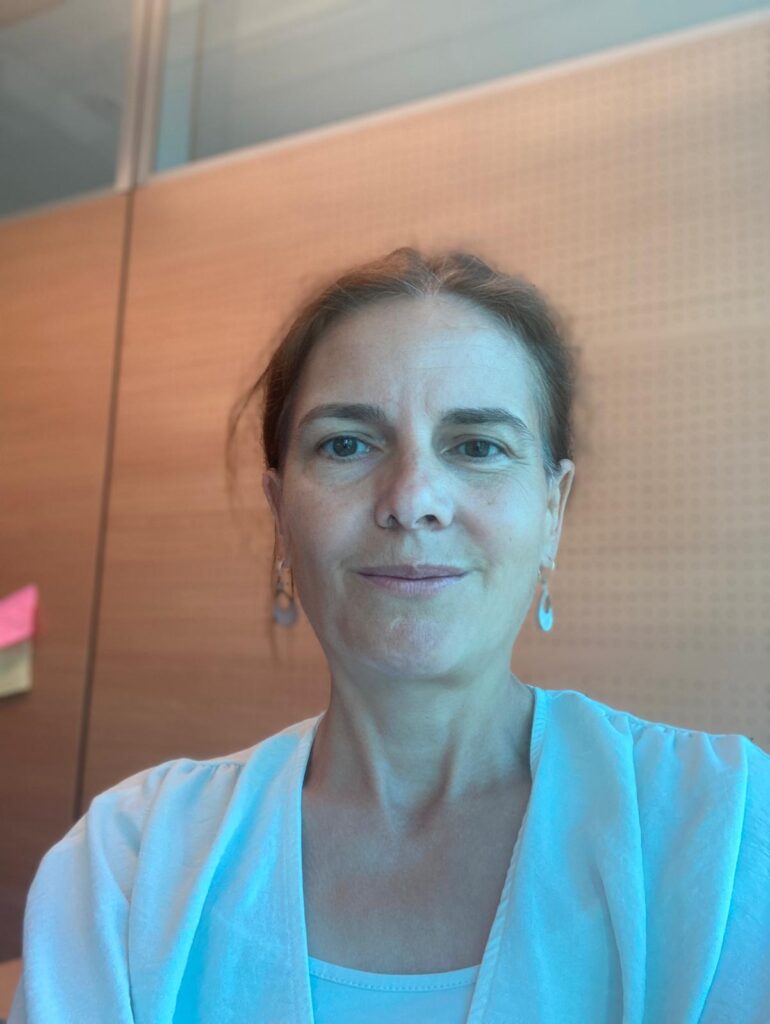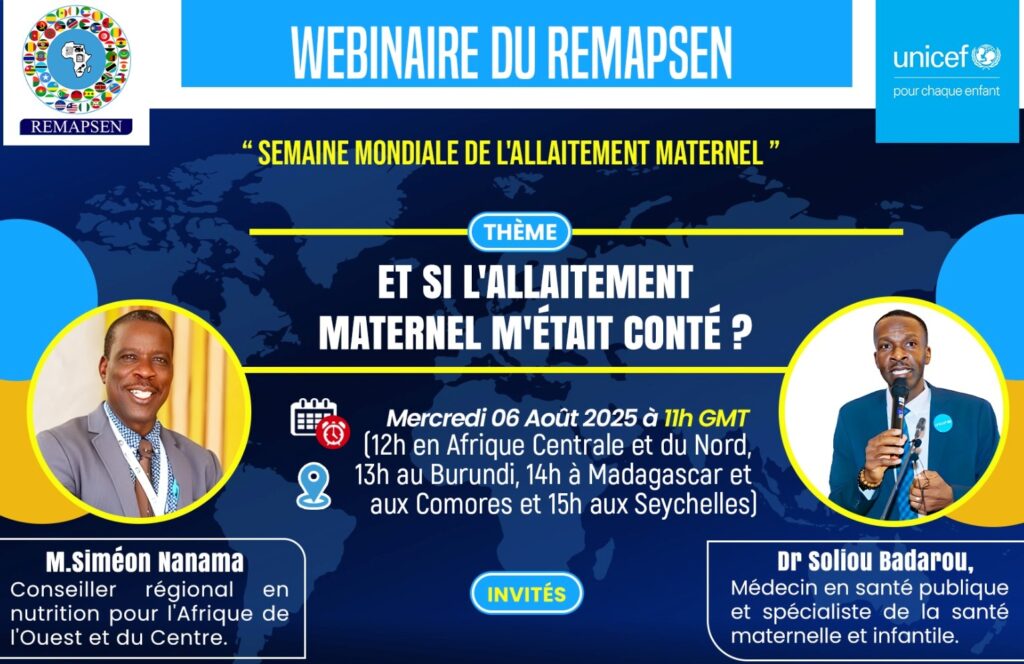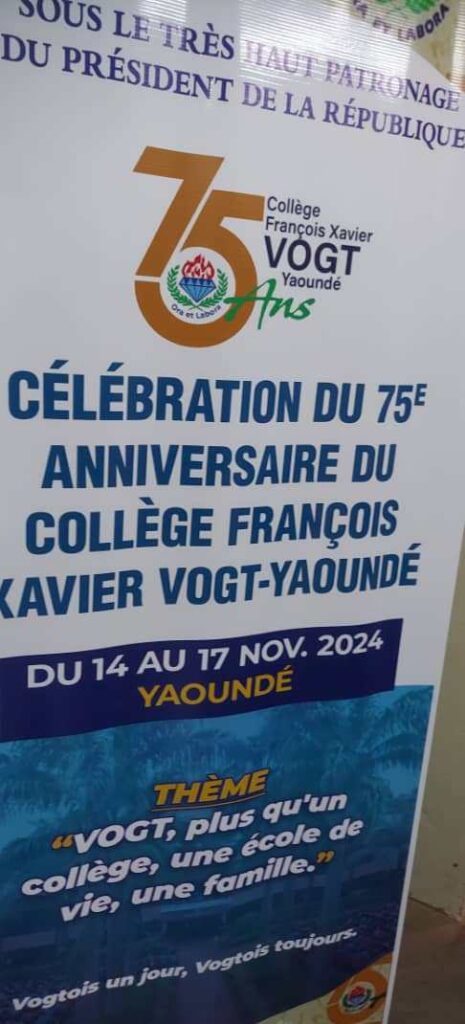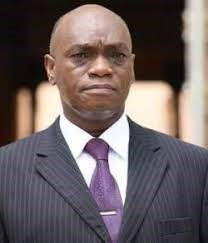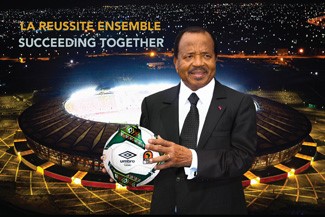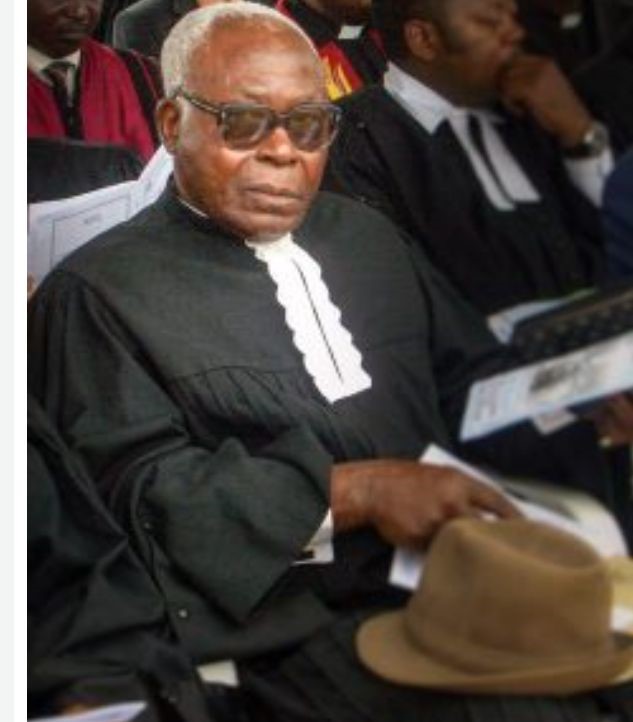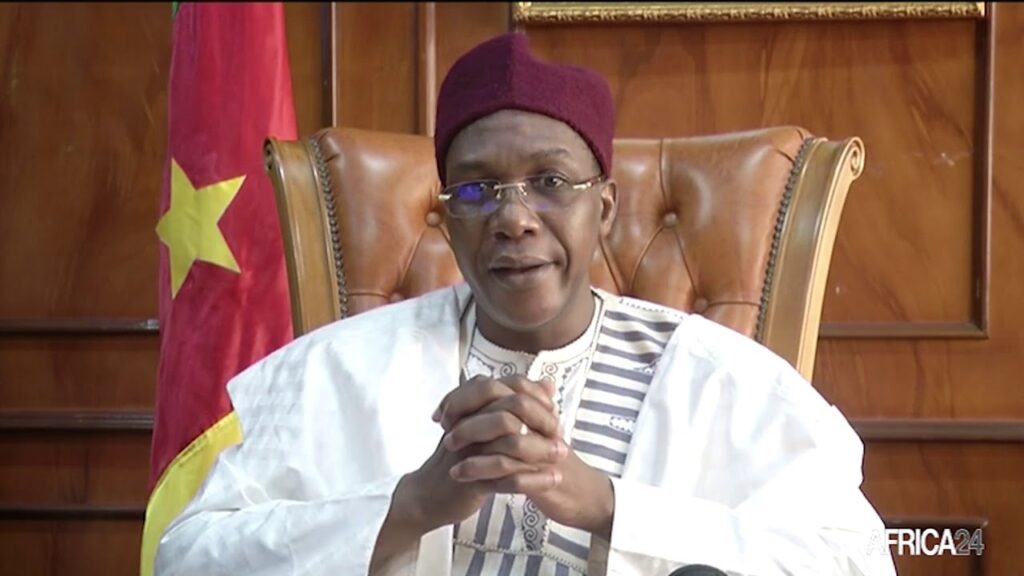Accès des adolescents aux services de santé : le RECAJ+ mobilisent les parties prenantes en vue d’une amélioration
La ville de Mbalmayo a abrité les 15 et 16 avril 2025, un atelier de restitution nationale du rapport d’analyse du contexte juridique camerounais relatif aux droits humains, avec un focus particulier sur les barrières qui entravent l’accès aux services de Santé. Les travaux tenus sous l’égide des services du premier Ministre ont mobilisé les représentants des administrations concernées et des formations sanitaires les partenaires au développement, les organisations de la société civile et les médias. L’objectif était de permettre aux participants de prendre connaissance du rapport produit par un expert national, de l’examiner, de valider collectivement les recommandations en vue d’une réforme juridique inclusive. De manière spécifique, il était question de présenter les principaux résultats et recommandations de l’évaluation, faciliter des discussions techniques sur les obstacles identifiés (lois, politiques, pratiques discriminatoires) et recueillir les contributions des parties prenantes pour enrichir le rapport et d’élaborer une feuille de route concertée pour le plaidoyer et la mise en œuvre des réformes juridiques et politiques. Il était aussi question de mettre en place un groupe de travail multi-acteurs pour le suivi des actions post-atelier. Le rapport présenté s’inspire de l’état des lieux qui ressort clairement que l’accès des adolescents et jeunes, en particulier des filles et des jeunes femmes, aux services de santé, notamment en matière de santé sexuelle et reproductive, reste limité en raison de divers obstacles juridiques et socioculturels. Pour répondre à ces défis, l’ONUSIDA a initié le projet « La réponse communautaire à la stigmatisation, la discrimination et la réforme législative en Afrique de l’Ouest et du Centre », déployée dans six pays, notamment le Bénin, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la République Centrafricaine (RCA), le Sénégal et le Togo, en collaboration avec des organisations communautaires. Au Cameroun, le Réseau Camerounais des Adolescents et Jeunes Positifs (RéCAJ+), avec l’appui technique et financier de l’ONUSIDA, œuvre à améliorer l’accès des adolescents, filles et jeunes femmes à des services de santé inclusifs et respectueux des droits humains. Dans cette optique, un consultant expert juridique a été recruté pour mener une évaluation des obstacles juridiques au droit à la santé des adolescents et jeunes au Cameroun, avec un accent particulier sur la santé sexuelle et reproductive. Cette étude a abouti à un rapport qui met en évidence les principales barrières existantes et formule des recommandations en vue d’une réforme juridique, législative et réglementaire adaptée. Les principaux obstacles identifiés sont notamment l’absence d’une définition juridique des notions de jeune et adolescent, l’ absence de fondement juridique de la « majorité sanitaire » appliquée par certains services de santé sexuelle et reproductive, la barrière du secret professionnel sur le statut sérologique, l’ absence de texte national internalisant les clauses du protocole de Maputo, l’ absence d’un statut juridique formel applicable aux agents de santé communautaire et les sanctions pénales insuffisamment dissuasives en matière de mutilations génitales . Au rang des obstacles socioculturels, le rapport souligne les stéréotypes de genre, les tabous et secrets, l’Influence des chefs traditionnels, l’ignorance des droits sexuels et reproductifs par les adolescents et jeunes, les perceptions des IST comme des maladies de la honte sociale, la perception du sexe comme tabou, la perception de certaines interventions de SRA, notamment la planification familiale, comme une voie vers l’infertilisation des jeunes filles. L’on note aussi l’ancrage de certaines pratiques socio-culturelles néfastes, le relâchement de l’encadrement familial, la faible scolarisation de la jeune fille dans certaines Régions et l’implication insuffisante des leaders religieux, traditionnels et culturels dans la santé reproductive. Le rapport évoque aussi les obstacles économiques avec notamment la pauvreté, le manque de ressources, les coûts élevés des services de santé sexuelle et reproductive peuvent être, le manque de moyens financiers des jeunes qui ne disposent pas encore d’autonomie financière, la précarité des familles, le coût élevé des prestations, examens et médicaments. Parmi les obstacles idéologiques, il y a les idées conservatrices, les croyances religieuses et les stéréotypes de genre. Les obstacles psychologiques également identifiés sont entre autres la Stigmatisation, la honte et la culpabilité, le manque de confiance, la méfiance envers le personnel médical et la Peur de la réaction des autres. Le rapport relève aussi des obstacles institutionnels qui caractérisés par l’accessibilité géographique limitée des Unités de Santé Reproductive des adolescents, l’insuffisante prise en compte de la santé mentale des jeunes vivant avec le VIH/SIDA, l’offre sanitaire insuffisante, la pénurie de personnel qualifié et en nombre suffisant et le déficit de communication sur l’existence et l’offre des services. Pour adresser ces nombreux problèmes identifiés, plusieurs recommandations ont été formulées. Entre autres : l’adoption d’une loi nationale sur la santé sexuelle et reproductive au Cameroun, l’adoption d’un texte réglementaire sur le statut d’Agent de Santé Communautaire pour conférer à ces acteurs qui occupent une place de choix dans le système de santé, le statut de travailleur temporaire, occasionnel ou saisonnier, selon les cas, la prise d’un arrêté du Ministre de la Santé publique pour donner force de droit au Guide du Comité National de Lutte contre le SIDA (Recueil des Directives), et le renforcement de la sensibilisation/information/éducation sur la santé sexuelle et reproductive. Prince Mpondo