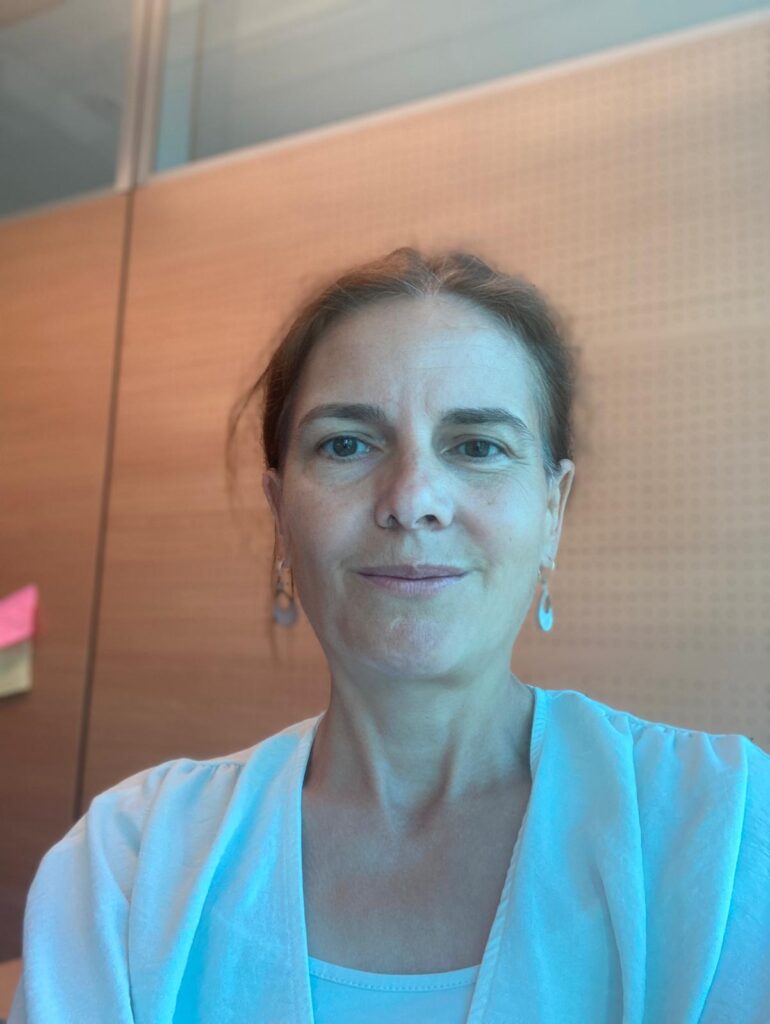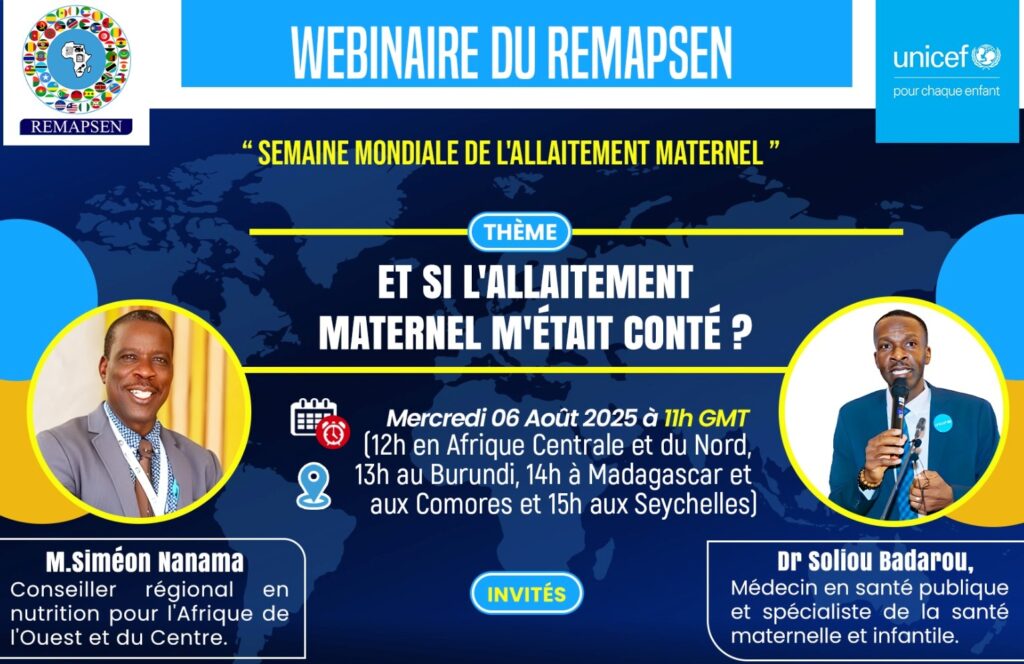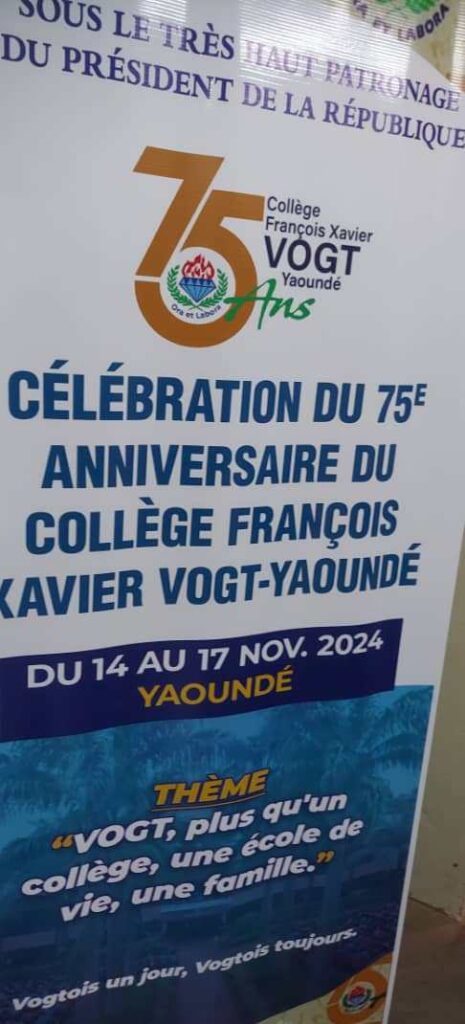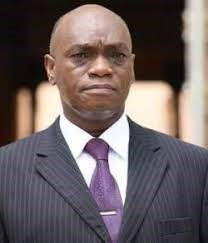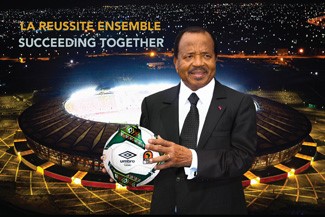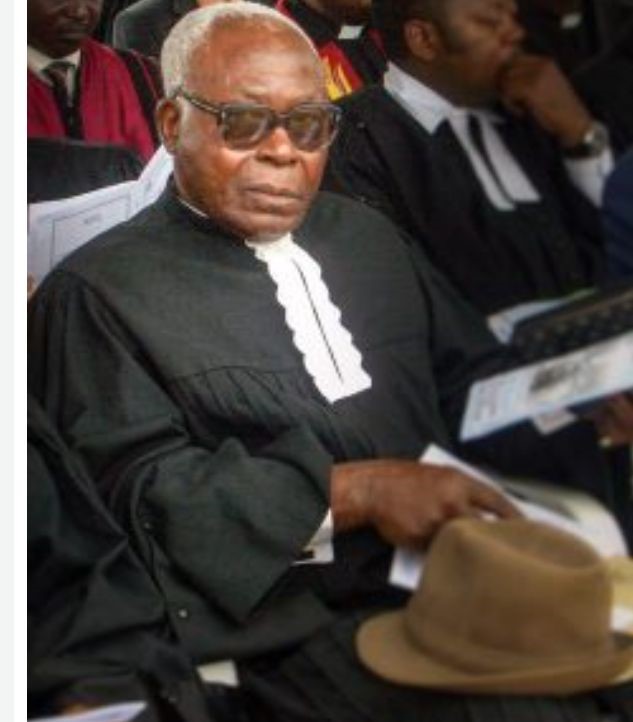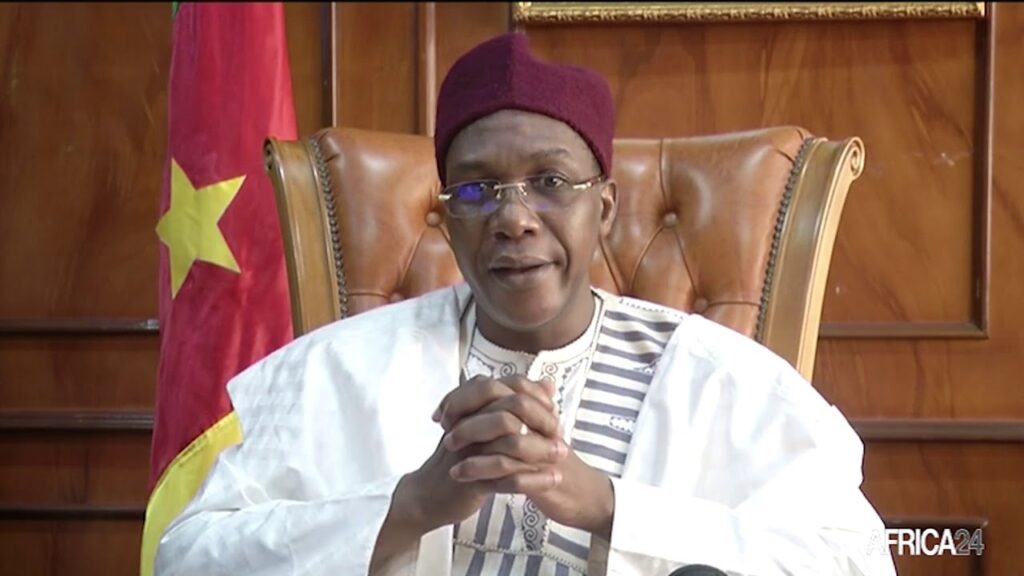ANALYSE : L’inclusion des PHV au Cameroun, du droit formel au droit réel : le défi de l’opérationnalisation
Le 16 décembre 2025, le CJARC a dévoilé son plaidoyer pour le recrutement des Personnes Handicapées Visuelles (PHV). Au-delà de la simple revendication catégorielle, cette initiative soulève une question centrale pour l’émergence du Cameroun : comment transformer un arsenal juridique exemplaire en une réalité économique tangible ? 1. Le paradoxe de l’ « invisibilité » des diplômés handicapés Le Cameroun dispose de l’un des cadres juridiques les plus protecteurs de la sous-région. Entre la ratification de la CDPH en 2021 et le décret de 2018 sur l’emploi protégé, l’État a théoriquement verrouillé le droit au travail pour tous. Pourtant, une fracture persiste. L’analyse du CJARC révèle un paradoxe : alors que les universités camerounaises forment chaque année des PHV qualifiés, ces derniers disparaissent des radars une fois sur le marché de l’emploi. Ce « gaspillage de capital humain » est dû à une perception erronée du coût de l’aménagement du poste, souvent surestimé par les employeurs (publics comme privés) par rapport au gain de productivité réel de ces travailleurs. 2. Le « Recrutement Inclusif » : un levier de modernisation administrative Le plaidoyer présenté au MINFOPRA et au GICAM ne demande pas la charité, mais la modernisation. Intégrer une PHV aujourd’hui, c’est nécessairement intégrer les technologies numériques (logiciels de revue d’écran, interfaces vocales). En poussant pour l’accessibilité des concours et des postes, le CJARC force indirectement l’administration camerounaise à accélérer sa transformation digitale. L’inclusion devient alors un moteur d’innovation : un environnement de travail accessible à un aveugle est, par définition, un environnement plus ergonomique et numérisé pour tous les employés. 3. La Canne Blanche : le baromètre de la citoyenneté L’originalité de l’approche du CJARC ce 16 décembre réside dans le couplage du plaidoyer « Emploi » avec celui de la « Canne Blanche ». C’est une analyse systémique de l’inclusion : On ne peut pas être productif si l’on ne peut pas accéder au bureau (problème de mobilité urbaine). On ne peut pas être respecté dans son entreprise si l’on est stigmatisé dans la rue. Le plaidoyer « Un code pour tous » rappelle que l’inclusion professionnelle est indissociable d’une politique de la ville inclusive. La canne blanche n’est plus seulement un outil technique, elle devient un symbole de droit de cité. 4. Les verrous à lever : quotas et sanctions L’analyse des résultats attendus montre que le dialogue est amorcé. Cependant, pour que ce plaidoyer de décembre 2025 ne reste pas lettre morte, deux leviers devront être actionnés par les pouvoirs publics : L’incitation fiscale : Encourager le secteur privé (GICAM) via des déductions pour chaque poste aménagé. La contrainte de quota : Passer de la recommandation à l’obligation de résultats dans les recrutements de la Fonction Publique, comme le suggère la Commission des Droits de l’Homme (CDHC). En conclusion; l’initiative du CJARC marque un changement de paradigme : on passe de la protection sociale (fondée sur la vulnérabilité) à l’inclusion économique (fondée sur la compétence). Dans un contexte où le Cameroun vise une croissance inclusive, l’intégration des PHV n’est plus une question de solidarité, mais un impératif de justice sociale et d’efficacité économique. Le message est clair : la société de 2026 se construira avec tous ses talents, ou elle ne se construira pas.